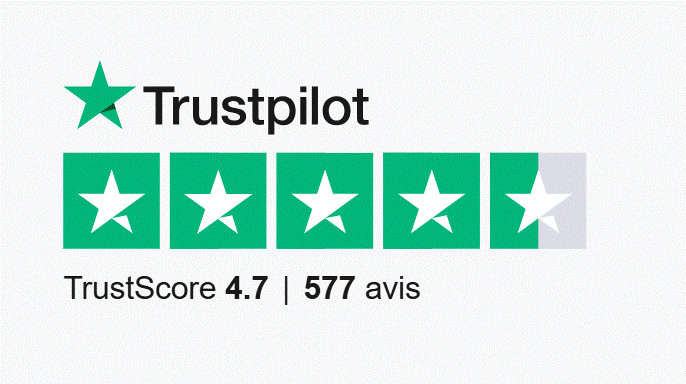Les banques utilisent l’argent laissé sur les comptes bancaires des Français ?
Chaque mois, des millions de Français laissent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros sur leur compte courant. Cet argent, souvent non rémunéré, peut sembler « dormant ».
En réalité, il est activement utilisé par les banques, qui en font un levier stratégique essentiel pour leur rentabilité.
Mais que deviennent exactement ces fonds ?
Et pourquoi les établissements bancaires les apprécient-ils autant ? Explications par un courtier en crédit.
Des centaines de milliards d’euros sur les comptes à vue
Selon les dernières données de la Banque de France, les dépôts à vue — c’est-à-dire l’argent disponible immédiatement sur les comptes courants s’élevaient à 752 milliards d’euros fin 2024.
Ce montant, bien qu’en léger recul, reste colossal. Il reflète un comportement d’épargne de précaution qui perdure, dans un contexte économique marqué par l’inflation, les incertitudes géopolitiques, et les ajustements de politique monétaire.
Ce qui est frappant, c’est l’extrême concentration de ces liquidités : seuls 12 % des comptes à vue disposent d’un solde supérieur à 10 000 €, mais ces comptes concentrent 83 % de l’encours total.
À l’inverse, près d’un tiers des comptes affichent un solde inférieur à 150 €. Une inégalité flagrante dans la détention de liquidités.
Une manne gratuite pour les banques
Ce que l’on appelle « dépôt à vue » ou « compte courant » est généralement non rémunéré. Autrement dit, les clients laissent dormir de l’argent qui ne leur rapporte rien. Pourtant, pour les banques, ces fonds constituent une ressource précieuse et hautement rentable.
Pourquoi ? Parce qu’ils sont :
Stables (flux réguliers de salaires, prélèvements…),
Accessibles à tout moment,
Et surtout, gratuits ou presque pour la banque, qui n’a pas à verser d’intérêts en contrepartie.
Que font les banques de cet argent ?
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces sommes ne dorment pas. Les banques en font trois grands usages, qui leur permettent de générer des revenus.
1. Prêter à d’autres clients
La mission première d’une banque est d’intermédier : collecter les dépôts pour financer l’économie réelle. Les liquidités non rémunérées servent donc à accorder :
Des crédits immobiliers,
Des prêts à la consommation,
Des crédits aux entreprises ou aux collectivités.
Le différentiel entre le taux d’intérêt prélevé sur ces prêts (par exemple 3 % à 5 %) et le coût nul ou quasi nul des dépôts est à l’origine de la marge bancaire, dite « marge d’intermédiation ».
2. Placer les excédents auprès de la BCE
Depuis la remontée des taux, la Banque centrale européenne (BCE) rémunère les dépôts des banques commerciales. En 2024, le taux de la facilité de dépôt était d’environ 3,75 %.
Ainsi, lorsqu’une banque collecte de l’épargne non utilisée immédiatement (ex. dépôt de salaire non dépensé), elle peut le placer à la BCE et toucher une rémunération garantie, sans risque.
Exemple : si une banque reçoit 10 000 € d’un client et les place temporairement à la BCE, elle peut générer environ 375 € par an… sans que le client ne perçoive le moindre centime.
3. Investir sur les marchés financiers
Les banques utilisent également une part de ces dépôts pour :
Acheter des obligations d’État,
Financer leur propre trésorerie,
Répondre aux exigences prudentielles de Bâle III via des actifs liquides de haute qualité.
Ces placements sont plus techniques et réglementés, mais permettent aux banques d’optimiser leur bilan en utilisant intelligemment les dépôts excédentaires.
Les banques mutualistes en première ligne
Les banques mutualistes (Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel) détiennent à elles seules environ 67 % des dépôts des particuliers et professionnels, selon un rapport de l’Institut Montaigne. Leur modèle coopératif et leur implantation territoriale expliquent en partie cette domination.
Elles captent une part majeure de l’épargne de précaution des Français, qu’elles utilisent ensuite dans leurs activités de crédit et d’investissement, tout comme les grandes banques commerciales (BNP Paribas, Société Générale…).
Une ressource rentable… mais peu transparente pour les clients
Il existe donc un décalage croissant entre :
L’usage actif que les banques font des dépôts à vue,
Et l’idée, encore largement répandue, que « l’argent dort » sur un compte courant.
Ce décalage est d’autant plus frappant depuis la remontée des taux. Là où un Livret A rapporte 3 % (et un LEP jusqu’à 5 %), le compte courant continue de ne rien rapporter. Pire : certains comptes peuvent générer des frais de tenue de compte ou des frais d’incident, même lorsque le solde est positif.
Une opportunité manquée pour les ménages ?
Pour le client, laisser plusieurs milliers d’euros sur un compte courant est souvent synonyme de sécurité. Mais c’est aussi une perte d’opportunité financière. En période de taux élevés, ces fonds pourraient :
Être placés sur un livret réglementé,
Servir d’apport pour un investissement immobilier,
Être utilisés pour diversifier son patrimoine (SCPI, assurance-vie, compte à terme…).
Une épargne liquide, mais sous-optimisée
Les comptes courants ne sont pas de simples boîtes de dépôt passives. Pour les banques, ce sont des réservoirs de liquidités extrêmement rentables. Mais pour les clients, ils représentent souvent une épargne inefficace, voire pénalisante sur le long terme.
Mieux comprendre le fonctionnement des dépôts à vue, c’est aussi mieux se former aux mécanismes bancaires et aux logiques économiques de l’intermédiation. Chez Cibformation, nous formons les futurs courtiers, conseillers et professionnels du crédit à ces enjeux essentiels.
Vous songez à vous reconvertir en courtier en crédit ou en assurance ?
Rejoindre le secteur du courtage, c’est faire le choix :
D’un métier utile, au cœur des décisions patrimoniales de vos clients ;
D’une activité porteuse, même en période de mutation du marché bancaire ;
D’une autonomie professionnelle, avec ou sans création de structure.
Découvrez nos formations IOBSP et IAS, éligibles au CPF et accessibles à distance, sur www.cibformation.fr.

Notre centre de formation est spécialisé pour les IOBSP et IAS
Nous dispensons une formation IOBSP et IAS Formule la plus complète avec un accompagnement personnalisé.- Depuis 2012, nous dispensons la formation IOBSP niveau 1, 2 et 3 ainsi que IAS et désormais une formation Loi ALUR.
- Chaque stagiaire est suivi par une coordinatrice pédagogique qui vous accompagne du devis à la remise de votre attestation de formation.
- La formation est débriefée par 2 jours de visio avec un courtier expérimenté. Le transfert hypothèque est abordé. Plébiscité par nos apprenants (voir les avis)
- Formation lutte contre le blanchiment d’argent
- Formation continue DCI 7h
- Formation continue IAS DDA 14 h
- Téléphone au 04 77 32 38 00
- Via notre site : Formation IOBSP/IAS
- Mail : accueil@cibformation.fr
 Centre certifié conformément au décret qualité N° 2015-790 du 25 juin 2015. Nous avons reçu la certification QUALIOPI, ainsi votre formation peut être prise en charge par le CPF, si elle est éligible. La formation peut aussi être prise en charge par votre OPCO. Nous sommes inscrits sur le catalogue qualité de Pôle Emploi et enregistré au DATADOCK.
Centre certifié conformément au décret qualité N° 2015-790 du 25 juin 2015. Nous avons reçu la certification QUALIOPI, ainsi votre formation peut être prise en charge par le CPF, si elle est éligible. La formation peut aussi être prise en charge par votre OPCO. Nous sommes inscrits sur le catalogue qualité de Pôle Emploi et enregistré au DATADOCK.